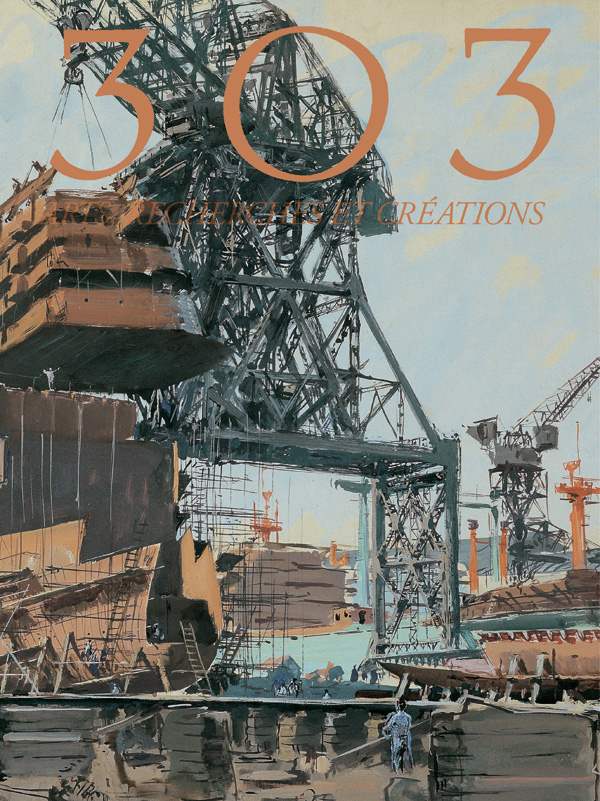Beaucoup d’entre nous croient connaître le travail de Michel Raimbaud tant ses Folles Gabares ont frappé notre imaginaire.
Peu imaginent la générosité qui prévalait à l’édification de ces ahurissantes structures éphémères, car souvent involontairement livrées à la destruction du temps.
 La photographie a beaucoup donné à Michel Raimbaud. Photographiées avec soin, certaines de ses œuvres, parmi les plus monumentales, ont, de nos jours, disparu. Lors de ses premières expositions, en particulier en 1974 au musée de l’abbaye Sainte-Croix, l’artiste concevait le catalogue comme un portfolio : de beaux clichés en noir et blanc, très contrastés, imprimés sur carte épaisse, mettaient en scène sur la plage ses sculptures, bois assemblés et peaux de vache, comme des formes organiques. Sur la grève, les rochers affleuraient, formes rondes et animales, tandis que la lumière blanche, presque irréelle, glissait sur la surface de l’eau. La vision photographique choisie par Raimbaud rappelle en tous points celle des images de Lucien Clergue qui mit en scène des modèles nus dans, par exemple, la série Née de la vague1 : le corps féminin, sculptural et acéphale, est offert, sensuel, aux caprices des vagues, sur la plage. Le grain de la peau, les rondeurs, jouent la métaphore du sable avec les plis et la matière. Dans l’œuvre sculpté de Raimbaud prévaut cette même volonté de rendre la créature imaginée à son origine première. Retour aux sources et ambiguïté.
La photographie a beaucoup donné à Michel Raimbaud. Photographiées avec soin, certaines de ses œuvres, parmi les plus monumentales, ont, de nos jours, disparu. Lors de ses premières expositions, en particulier en 1974 au musée de l’abbaye Sainte-Croix, l’artiste concevait le catalogue comme un portfolio : de beaux clichés en noir et blanc, très contrastés, imprimés sur carte épaisse, mettaient en scène sur la plage ses sculptures, bois assemblés et peaux de vache, comme des formes organiques. Sur la grève, les rochers affleuraient, formes rondes et animales, tandis que la lumière blanche, presque irréelle, glissait sur la surface de l’eau. La vision photographique choisie par Raimbaud rappelle en tous points celle des images de Lucien Clergue qui mit en scène des modèles nus dans, par exemple, la série Née de la vague1 : le corps féminin, sculptural et acéphale, est offert, sensuel, aux caprices des vagues, sur la plage. Le grain de la peau, les rondeurs, jouent la métaphore du sable avec les plis et la matière. Dans l’œuvre sculpté de Raimbaud prévaut cette même volonté de rendre la créature imaginée à son origine première. Retour aux sources et ambiguïté.
Les amis photographes de Raimbaud ont permis de garder en mémoire des œuvres disparues, comme ses Folles Gabares. En l’absence de l’artiste, un chantier documentaire a vu le jour pour retrouver le fil de son travail. Chacun, par des reproductions, croit connaître l’œuvre de Raimbaud et ignore sans doute l’élaboration généreuse de constructions éphémères, sculptures assemblées sur plages et places livrées à la destruction du temps ou démontées après la saison. La disparition appartient à un libre arbitre poétique éloigné de toute considération théorique : « J’ai regardé souvent les merveilleux nuages dans le ciel, formes d’air et formes d’eau, qui refont et se défont à la fois, structures d’enchantement – choses inaccessibles et présentes, avec leur peau d’apparence, belles images sur un réel d’autre chose2 », écrivait l’artiste. Peut-on parler à son propos d’intervention dans le paysage, dans un esprit proche du Land Art ? Les « sites » de Smithson s’inspiraient du concept d’entropie, de transformations : de l’ordre au chaos, du chaos à l’art. La présence des sculptures de Raimbaud dans le paysage tient davantage de l’empathie, d’une tentative fusionnelle et affective.
Michel Raimbaud a laissé dans ses œuvres des idées fortes et maîtrisées, des enchaînements et des proliférations n’appartenant qu’à lui. Du mot préparé avec gourmandise – un prénom vaut mieux qu’un titre – à l’objet adopté, rafistolé et ennobli, il avançait par libres associations. La Folle Gabare à la charrette construite dans son jardin du château d’Olonne témoigne de ce dessein de ne rien laisser sans suite. Régulièrement, aidé de ses amis, il entretenait cette œuvre en perpétuelle expansion en y agrégeant de nouveaux éléments : filets, morceaux de cuir, lanières, cordes, échelles, pièces de bois… Ce qui au départ était une charrette volante devint une ahurissante cabane, une sorte de Merzbau végétal, marin et vernaculaire. Le rapiéçage et l’assemblage, exercices de pauvreté, convenaient à Raimbaud partageant avec Chaissac le goût de la jaille. Une dernière exposition à Nantes en 1998, Serpent de mer, illustrait bien ce souci de ne pas achever la figure : « Le serpent de mer est un mouvement qui emporte des sculptures dans une sculpture3. » Le fantastique nichait dans les circonvolutions, les anneaux, les béances du monstre constitué de formes en cuir durci assemblées. Le serpent est une mue, une poignante concrétion autour du vide, une métaphore totalisante.
La biographie de Michel Raimbaud fait apparaître deux attachements. Le premier ramène au monde populaire (un père ébéniste, une mère couturière). Toujours avec malice, dans le détournement parfois, Raimbaud revendiquait ses racines vendéennes, l’admiration de la mer, mais aussi celle du beau métier. Il revendiquait celui-ci en tant qu’artisanat pour peu qu’on ne l’abandonnât pas au hasard, par désinvolture. Le second attachement se reconnaît dans son parcours d’enseignant à l’École alsacienne, à Paris, au collège du Centre aux Sables : « Il a le double souci d’apprendre pour lui-même et d’apprendre aux autres4. » Raimbaud a accompagné par ses conférences, ses présentations, la naissance d’un musée d’art contemporain dans sa ville. Il y avait chez lui un mélange heureux de curiosité, de néologismes ou parler chaumois, et de culture littéraire. Ses articles, ses poèmes, allient langage parlé et solide érudition. Lire Raimbaud, c’est l’écouter et le voir, séducteur et démonstratif, évoluant au milieu de ses sculptures.
Retraçant en quelques étapes significatives le parcours artistique de Raimbaud, son évolution, nous pouvons affirmer avec lui que passant du tableau au relief mural, du totem à la « cabane » creuse habitée, il a changé. De peintre, il est devenu sculpteur, voire architecte anticonformiste.
Il abandonna la pratique picturale traditionnelle (chevalet, couleurs en tubes, châssis…), pour une ultime expérience en peignant sur peau de vache ou cul de chalut5 La Paire initiale (1968). Le vieux cuir abandonné par les marins devenait son matériau électif : ductile une fois humecté, il a la faculté de durcir puis d’épouser les formes en séchant. Avec la peau de vache, Raimbaud réalisa donc des reliefs sur châssis. D’après lui, le cuir « évacué de toute idée de mort6 » permettait nombre de combinaisons sur le dessus et le dessous du corps. Il l’utilisait pour ses scarifications, ses traces d’usure, il le gonflait de bois flottés, de cailloux et fermait le tout de coutures. Ostentatoires et vulnérables à la fois, les peaux de Raimbaud ramenaient au mythe, à l’élémentaire : « au bord des grèves la peau du monde est nue, beau cimetière sans pourriture7 ». Avec La Honra (1970), le cuir sombre prenait la dignité d’un Christ espagnol ; avec la Cahouenne vorace (1970), une carcasse de crabe exsangue laissait apparaître ses viscères, en écho aux affrontements en Palestine à la même époque. L’éreintement de la matière, chiffonnée, découpée et tendue, les ligatures croisées et les trouées, de la surface au fond, évoquent les œuvres austères de Millares ou de Tapiès.
Dès lors, la sculpture peut s’épanouir librement. Béluga (1971), gros poisson fantastique, était composé d’un squelette incertain en bois sur lequel Raimbaud avait cousu comme une membrane de grands lambeaux de cuir. Plus troublante furent les figures anthropomorphes tels Le Reître écorché (1971) ou Belphégor (1971). L’artiste gaînait intégralement et étroitement des troncs d’arbres. Trente ans après, on est étonné par l’allure suggestive de ces Hermès de plage, avec leurs masques cousus serrés, comme des capuchons de bourreaux. Le cuir, peau d’animal épilée et tannée, est associé depuis longtemps à l’imaginaire fétichiste : « L’attirance pour le cuir est surdéterminée : ses caractéristiques sensorielles sont le dur et le brillant, une odeur particulière et un son crissant8. » Si les exemples cités ci-dessus peuvent paraître exagérés, pure invention de l’auteur, il n’échappera à personne que le cuir forme un appel plus ou moins latent à la sexualité ou, en bas régime, à la sensualité. Les petites sculptures en cuir chromé bleu des années quatre-vingt, drapant des segments de bois poli, sont à cet égard éloquentes : Tête de Maure, Melchior, Gaspar…
En 1973, Michel Raimbaud obtenait le prix André Susse au salon de la Jeune Sculpture pour son œuvre La Gargamoëlle aux oyseaux. Une année plus tard, il exposait au salon de Mai sa première Folle Gabare : près de vingt autres virent le jour. Il n’est pas inutile de rappeler l’effervescence qui régnait alors dans le milieu artistique. Une frange de Support-Surfaces s’intéressait à l’artisanat, à l’insertion dans le paysage, au choix des matériaux. La Gargamoëlle et Folles Gabares allaient dans le sens d’une générosité toute sociale, d’une théâtralité altruiste. En 1979, Raimbaud occupait le patio du musée des Beaux-Arts de Nantes avec une immense Gabare : sa production arrivait à maturité, à sa marque d’auteur, avec des reliefs spécifiques et des vocables roulant en bouche.
La gargamoelle aux ouyseaux jardin du luxembourg[/caption]La Gargamoëlle aux oyseaux de 1973, dont, sans doute, un arbre entier formait l’ossature, est un étrange vaisseau propre à accueillir des enfants qui ne s’en privèrent pas lors de son exposition dans les jardins du Luxembourg. Entre ciel et terre, elle est à la fois véhicule et cheval de Troie, ou plutôt une sorte de LEM préhistorique. La Gargamoëlle fut la concrétisation parfaite, matricielle, de la pensée de Raimbaud, fermée sur l’être et ouverte sur le vaste monde. Il faut sans doute la mettre en rapport avec les architectures utopiques et alternatives qui ont fleuri sur la côte ouest des États-Unis dans les années soixante-dix. Comment ne pas penser aussi aux maisons naturelles construites plus tôt par l’architecte Bruce Goff (maisons Bavinger, Harder…) ? Celui-ci haubanait les toits, utilisait les membrures, tiges et tuyaux, valorisait la pierre naturelle. Ainsi les Folles Gabares s’élevaient-elles à la fois comme des maisons, des bateaux avec leurs voiles : concilier prise au vent et nécessaire ancrage à la terre. Avec leurs peaux d’animaux entières et tendues, encordées, entre mâts et vergues de fortune, on pouvait y voir des élytres ou des ailes. Destinées aux lieux publics, aux plages peuplées d’estivants, Tanchet ou Remblai aux Sables, bonnes mères, les Gabares accueillaient les enfants (les directives actuelles en matière de sécurité interdiraient de tels débordements festifs…). Au terrain de jeux s’ajoutait l’offrande à l’Océan : la sculpture rendait aux flots ce que l’artiste avait patiemment collecté. Dans le même temps, se superposèrent à ces Gabares des sculptures plus petites, comme des maquettes, ou plus raisonnables, comme Chênarbanne (1979), dont les pièces de bois constitutives absorbaient de la couleur primaire, à la Mondrian. Plus tard, Raimbaud ne devait préserver que la coquille de peau, comme une armure vide : ainsi ses Cavernes marines et Grands dos, dans les années 1980, pourraient cacher quelque chose comme l’énigme d’Isidore Ducasse. La sculpture s’affranchissait de son ossature, abandonnait sur le sol comme des culottes ou des vêtements vides et pétrifiés en attente d’un corps.
En juillet 1998, Michel Raimbaud participait, avec la compagnie Catherine Massiot, au spectacle nocturne de danse du château de Pierre Levée, La Nef des Fols, faisant référence à l’œuvre de Jérôme Bosch. Il s’agissait de fondre en d’improbables épousailles le corps des danseurs et comédiens et les sculptures en cuir et bois flottés. Démiurge, Raimbaud réalisait ainsi son rêve, mettant en mouvement son intuition. Dans L’Homme-racine, un danseur nu surgissant par les fesses d’une peau de vache soulignait de manière expressive cette alliance entre les défroques animales et le corps, objet de toutes les sollicitudes. D’une peau à l’autre.
Benoît Decron